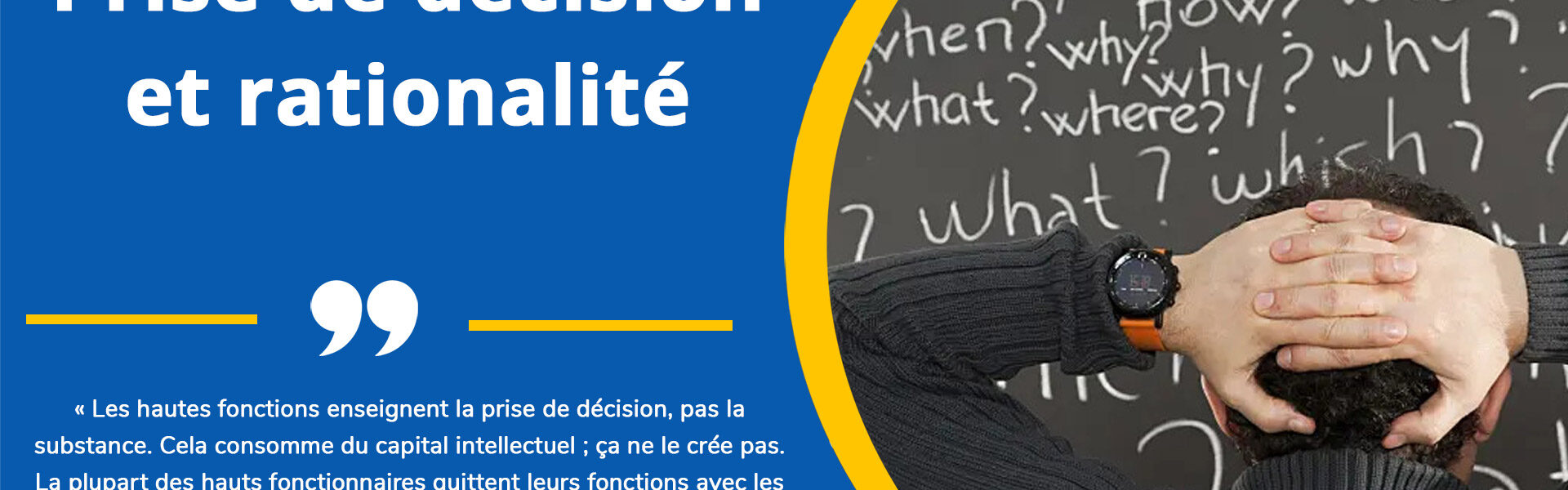Selon l’auteur Samuel Fitoussi, la capacité à faire preuve de rationalité ne garantit pas une prise de décision éclairée. Fitoussi soutient que les intellectuels sont souvent victimes d’une rationalité sociale qui leur fait privilégier des vérités idéologiques sur les réalités objectives.
L’auteur souligne qu’au cours du 20e siècle, l’intelligentsia occidentale a maintenu une vision positive du communisme malgré le bilan humain catastrophique de ce régime politique. Cette cécité est attribuée à un biais cognitif : la difficulté d’accepter des informations contradictoires face à ses convictions préétablies.
Fitoussi critique également le monde académique, en particulier les sciences sociales, pour leur propension à adopter une approche idéologique plutôt qu’une méthodologie scientifique rigoureuse. Les intellectuels, selon lui, se sentent souvent autorisés par leurs diplômes à détenir la vérité et influencent de ce fait l’opinion publique.
L’influence de l’intelligentsia sur les politiques publiques est également remise en question. Fitoussi suggère qu’un certain nombre de politiques imposent un fardeau disproportionné aux classes populaires, alors que leur conception intellectuelle prétend viser le bien commun.
En conclusion, Fitoussi met l’accent sur la fragilité humaine et remet en question l’idée selon laquelle les élites intellectuelles sont mieux placées pour imposer leurs vérités à la société. La connaissance est subjective et les erreurs ne sont pas cantonnées aux générations passées.
Ce livre invite à une réflexion critique sur le rôle des intellectuels dans la formation de l’opinion publique et du débat social, sans pour autant nier leur importance dans la construction d’un monde plus éclairé.